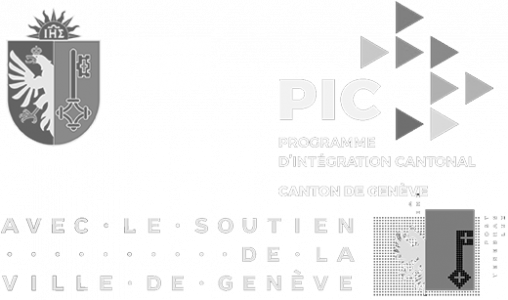Maurice Gardiol (protestant réformé)
Mon regard sur la réalité de la violence à partir de mes convictions
 La vie est une lutte entre forces de vie et forces de mort qui peut entraîner diverses formes de violence. Nous pouvons considérer, comme le suggère des penseurs comme René Girard ou Jacques Ellul que cela fait partie de l’ordre des nécessités. Toutefois ces nécessités entraînent l’être humain dans un cercle vicieux infernal s’il ne se donne pas des règles pour sauvegarder à la fois son environnement et sa relation aux autres. Les religions ont participé à l’élaboration de ces règles de diverses manières par l’enseignement éthique de leurs maîtres ou de leurs textes.
La vie est une lutte entre forces de vie et forces de mort qui peut entraîner diverses formes de violence. Nous pouvons considérer, comme le suggère des penseurs comme René Girard ou Jacques Ellul que cela fait partie de l’ordre des nécessités. Toutefois ces nécessités entraînent l’être humain dans un cercle vicieux infernal s’il ne se donne pas des règles pour sauvegarder à la fois son environnement et sa relation aux autres. Les religions ont participé à l’élaboration de ces règles de diverses manières par l’enseignement éthique de leurs maîtres ou de leurs textes.
Dans la tradition judéo-chrétienne, les 10 Paroles (ou dix commandement) remis à Moïse, en sont la démonstration. On trouve aussi l’idée de contenir ou de circonscrire les violences qui nous habitent dans le second récit de la Création (Genèse 2). Dans celui-ci Adam (le Terreux) est invité à « nommer les animaux », ce qui lui confie une responsabilité écologique[1]. Avec Eve (la Vie) il est aussi appelé à « cultiver et peupler » la terre dont ils sont les « lieux-tenant » du Créateur. C’est de leur responsabilité économique, sociale et culturelle dont il est question ici.
Dans cette même tradition, la législation sur l’année sabbatique (tous les 7 ans) et plus particulièrement sur le Jubilé (marqué tous les 7 fois 7 ans) montrait dans quel esprit cette responsabilité devrait être comprise. Par la force des choses, des inégalités se creusent et cela a pour conséquence des violences, des exclusions et des injustices ainsi qu’un épuisement des ressources naturelles. Ces lois inscrivaient donc des limites et des devoirs : mise en jachère des terres, redistribution des richesses, libération des esclaves.
Dans l’Evangile, il nous est rapporté que Jésus reprend cet héritage en précisant que son message a justement pour but d’annoncer « une bonne nouvelle aux pauvres, …proclamer aux captifs la délivrance, …renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur » (Luc 4.16-22). Il réaffirme aussi les responsabilités confiées aux êtres humains de bonne volonté en les invitant à être « sel de la terre » et « lumière du monde » (cf Matthieu 5. 16-13). La théologienne orthodoxe Annick de Sounezelle suggère que cela peut aussi parler de nos animaux intérieurs que nous avons à découvrir et à dompter pour ne pas nous laisser emporter par leur violence.
Les manifestations individuelles et collectives de la violence
La question du sens de l’existence habite certainement tout être humain et les religions, mais aussi les diverses pensées philosophiques offrent des pistes en guise de réponses communautaires ou individuelles à ce questionnement. Il ne faut pas négliger les contextes historiques et culturels dans lesquels sont nées les diverses traditions religieuses. Il convient alors de relever ce qui dans ces traditions vient renforcer certaines croyances, attitudes et comportements, ou alors les remettre en question ou les contester.
Par rapport aux diverses peurs qui peuvent venir paralyser nos existences ou alors justifier nos défiances et nos violences, les évangiles nous font découvrir dans les paroles, les actes et les enseignement de Jésus une insistance particulière sur le fait de ne pas rester à terre, d’être relevés (autrement dit « ressuscités »), de retrouver la vision et de découvrir une mission qui donne sens à notre présence dans ce monde. Une mission qui consiste justement à redécouvrir notre responsabilité d’être humain, à ne pas nous laisser envahir par nos peurs mais à être orientés dans nos choix et dans nos engagements par « la force d’aimer » comme le disait le pasteur Martin Luther King.
L’étranger fait souvent peur à cause même de ses différences. Lorsque nous restons prisonniers de ce sentiment, alors nous construisons nos communautés, claniques, ethniques, nationales ou religieuses, comme des bunkers sensés nous protéger de toute contamination. Une attitude dont le corollaire est la volonté de détruire ou d’annexer l’autre en niant ce qu’il est, ce qu’il vit et ce qu’il croit. C’est la stratégie du repli et de l’exclusion, mais aussi celle des croisades, de l’inquisition, de l’impérialisme, du colonialisme, du nazisme ou de l’apartheid.
Dans son histoire passée ou plus récente, le christianisme n’a pas manqué de sombrer dans ces travers avec toutes les conséquences dramatiques que l’on sait. En cela il n’a pas été « lumière du monde », mais bien source d’obscurantisme et il porte une lourde part de responsabilité dans des violences inhumaines injustifiables.
En cela, il n’a pas été attentif à des textes dont il se réclame et qu’il aurait dû prendre plus au sérieux. Ainsi, toujours dans les récits du commencement (La Genèse) celui où Adam et Eve se découvrent nus est révélateur. Dieu doit venir couvrir leur nudité pour les protéger car la différence qu’elle donne à voir peut être mortifère au moment même où l’humain désire être « comme un Dieu » et ne peut donc accepter ne pas être « complet » à lui tout seul. Le récit suivant de Caïn et Abel montre aussi à quel point il nous est insupportable que l’autre, perçu comme un « moins que rien » (c’est ce que signifie le nom d’Abel) soit mieux considéré que nous. Dans le second Testament, l’apôtre Paul mettait déjà en garde les premières communautés contre ces risques d’exclusion des autres jugé différents parce qu’ils se réclamaient de l’enseignement d’un autre apôtre !
Il s’avère difficile dans l’histoire humaine de partager un même espace en ayant des convictions différentes. Même au sein d’une tradition religieuse des conflits sanglants peuvent être la conséquence de cette volonté d’imposer ses propres interprétations d’une même foi. Nous trouvons déjà la trace de cette intolérance, conçue comme une lutte contre des infidélités, dans les textes religieux eux-mêmes et ce sont ces écrits, dans une lecture littéraliste ou fondamentaliste qui sont le plus souvent utilisés pour justifier de tels comportements. Ceux qui le font prétendent ensuite agir « Au nom de Dieu » ou affirment de manière péremptoire que « Dieu est avec nous » !
Dans les textes prophétiques bibliques nous trouvons de nombreuses mises en garde contre de telles manières de faire et de chercher à utiliser le religieux pour prétendre défendre un Dieu que l’on veut s’approprier. Ainsi le prophète Amos met dans la bouche de Dieu ces paroles fortes : « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées… Eloigne de moi le bruit de tes cantiques ; je n’écoute pas le son de tes luths. Mais que la droiture soit comme un courant d’eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » (Amos 5 21-24)
Rappelons-nous aussi cette parole de Jésus au disciple qui veut le défendre par l’épée au moment de son arrestation : « Tous ceux qui prendront l’épée, périront par l’épée » (Matthieu 26.52). Une contestation fondamentale de l’usage de la violence pour défendre sa conviction.
Nous ne pouvons nier que l’alliance entre le politique et le religieux constitue un réel danger. Lorsque le pouvoir politique instrumentaliste le religieux, c’est en général pour consolider un pouvoir absolu. Les divers empereurs et rois de droit divin en ont été longtemps l’exemple, et certains dictateurs des temps modernes ont aussi recouru à cette alliance malsaine. Lorsque le religieux se confond avec le pouvoir politique on assiste également à toutes sortes de dérives et de crimes qui réduisent les religions à une forme de morale hypocrite au service des puissants.
Dans la tradition judéo-chrétienne, il n’y a pas de roi sans prophète, le rôle de ce dernier étant justement de distinguer ce qui est de l’ordre temporel et spirituel. D’où la tentation de certains rois de s’acheter la complicité de « faux-prophètes » lorsqu’ils ne veulent plus que leur pouvoir soit ainsi limité.
La parole de Jésus « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu » suite à une question qui lui est posée concernant l’impôt, marque bien aussi cette nécessité d’une distinction visant à éviter la confusion des rôles et des responsabilités. Le concept de laïcité, en tant qu’état d’esprit qui a progressivement précisé la nécessaire séparation de l’Etat et de l’Eglise est probablement en Occident un fruit des réflexions à la fois philosophiques et théologiques suite aux trop nombreuses guerres des religions dans lesquelles la confusion entre politique et religieux ont joué un rôle prépondérant.
Cela ne signifie pas que le Roi ou l’Etat n’ont rien à exiger des religions en matière de respect des lois, ni que les religions n’ont pas à faire entendre leur point de vue au Roi ou l’Etat sur des questions sociales, éthiques, voire même politiques. Nous pouvons mentionner à ce sujet les prises de position de l’Eglise confessante d’Allemagne qui a fait acte de résistance face au national-socialisme, ou celles du Conseil œcuménique des Eglises qui s’est opposée à l’apartheid en Afrique du Sud. Il s’agit d’actes de résistance en soutien aux victimes d’abus de pouvoir et non pas d’une volonté de sortir de son rôle et de sa responsabilité.
Prévenir et promouvoir des initiatives de paix, de justice et de réconciliation
Ces questions, pourrions-nous dire, mettent en évidence une tension existant entre la théorie et la pratique. Et que, comme pour beaucoup d’autres choses, tout dépend des motivations profondes et des intentions de celles et ceux qui s’en réclament. S’agit-il de trouver des justifications à ses propres choix pour les sécuriser et les imposer, ou s’agit-il de s’ouvrir à une interpellation spirituelle apte à nous questionner et à nous faire évoluer, grandir, dans d’autres perceptions de notre existence humaine et de nos relations aux autres.
Dans ce cas les diverses traditions religieuses renferment des richesses qui peuvent nous permettre non seulement de mieux saisir les limites et d’accepter des règles favorisant un vivre ensemble respectueux des convictions des uns et des autres, mais plus encore de s’ouvrir à de nouvelles libertés dans la manière de comprendre et de vivre notre foi.
Cette ouverture vers une nouvelle liberté s’inscrit dans un processus. A la fois dans la vie des communautés religieuses et dans nos propres existences. Parvenir à l’âge adulte nécessite de passer par diverses étapes. De même devenir adulte dans sa foi personnelle est un chemin. Trop de personnes qui ont l’âge d’être des adultes, mais aussi trop de personnes qui s’affirment croyantes, donnent l’impression de s’être arrêtées en chemin, de s’être égarées dans des voies sans issues dont elles ne souhaitent pas vraiment sortir.
Heureusement d’autres exemples nous sont donnés qui nous encouragent à ne pas rester figés sur un acquis provisoire. Jésus lui-même se laisse interpeller par une femme cananéenne, qui l’oblige à changer son regard sur l’étrangère qu’elle est et sur ses droits. Les apôtres apprendront aussi par la suite à modifier leurs points de vue afin de dépasser les barrières que les humaines érigent régulièrement entre eux.
La constitution en 1946 du Conseil œcuménique des Eglises a constitué un évènement considérable marquant une volonté de réconciliation entre les diverses communautés chrétiennes. Et cela suite à une redécouverte, de part et d’autre, des réelles exigences du message évangélique. Depuis lors le chemin dans cette voie se poursuit, avec des hauts et des bas, mais nous sommes convaincus que rien ne pourra arrêter cette marche vers une unité respectueuse de la diversité au sein des confessions chrétiennes.
Nous croyons aussi que le dialogue interreligieux qui a pu voir le jour dans plusieurs lieux ces trente dernières années est le fruit d’une vraie démarche spirituelle. Il ne s’agit plus simplement de se tolérer, mais plus profondément d’apprendre à se connaître afin de véritablement se respecter et de pouvoir même s’engager ensemble pour défendre ou soutenir certaines causes. C’est ainsi que l’Appel spirituel de Genève, réunissant des personnes de toutes religions et convictions, a pu diffuser un texte, traduit en de nombreuses langues, pour condamner toute utilisation de la religion pour justifier les violences et les guerres.
Si la division des confessions et des religions vient aviver les conflits, les violences et les injustices dans notre monde, le chemin vers l’unité et le dialogue constitue au contraire une force et un soutien extraordinaire pour toutes les initiatives de paix, de justice et de réconciliation.