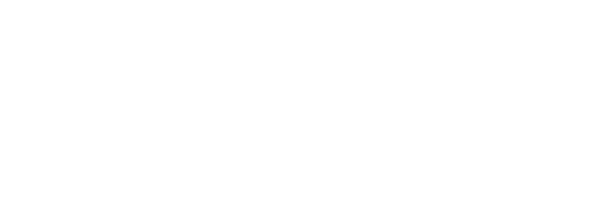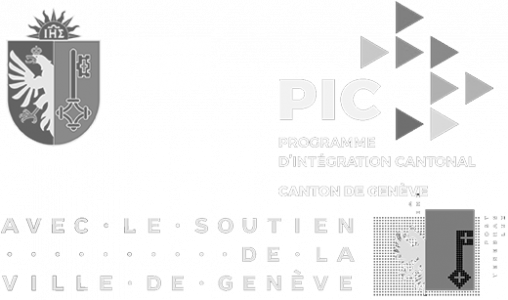Henri Maudet et Philippe Leu (protestants réformés)
Mon regard sur la réalité de la violence à partir de mes convictions
La violence a toujours, semble-t-il, existé sous diverses formes et a jusqu’ici accompagné l’Histoire de l’Humanité. Par ailleurs, il est clair que toutes les Ecritures saintes et toutes les religions contiennent un potentiel de violence en soi.
D’autre part, la dimension de nature, pour ce qu’il en est de la violence humaine, ne peut être considérée comme la première source de violence depuis le Néolithique. La violence humaine – du moins son acceptation légitime et sa définition – a été et reste une norme sociale; norme sociale qui s’est modifiée au fil du temps. Il semble bien que la vengeance, la prédation économique et la prédation sexuelle soient les trois sources de la violence humaine qui ont conduit à la lente élaboration de la justice.
L’histoire du protestantisme depuis les Réformateurs, des épisodes des Écritures (la Bible) et des récits concernant D’ieu confrontent également le protestant réformé à la réalité de la violence et aux réflexions au sujet de la violence. Sa tradition, la vie cultuelle l’amènent à reconnaître qu’il peut être acteur, victime ou témoin de violence(s). Sa tradition l’encourage à ne pas s’enfermer ni à se refermer dans l’une ou l’autre de ces positions, mais à corriger les risques qu’elles provoquent dans sa propre vie et/ou dans celle de l’autre, en vue de « garder et de cultiver » la vie.
L’Ecriture (la Bible) étant sa référence dans sa pratique et sa relation à D’ieu, sa lecture et ses interprétations du message biblique et évangélique lui donneront les moyens, soit de favoriser, soit de faire reculer la violence dont il – et/ou sa propre communauté-, est capable. Pour le protestant réformé, la violence est une réalité, sans pour autant être une fatalité. Ainsi, il n’est pas seulement invité à admettre l’existence et la présence de l’autre, ou à la tolérer, mais à «aimer son prochain », et à assumer ses responsabilités à son encontre. Les paroles imprécatoires contre D’ieu et les paroles de malédiction de D’ieu sont un moyen d’expression, pour le protestant réformé, de dénoncer les réalités mortifères qu’il subit et supporte, elles sont un outil pour dénoncer le Mal à l’oeuvre dans la Création.
Incité et invité à relire les Ecritures et à y découvrir des actions de violences (de D’ieu, de peuples ou d’individu) ou le témoignage des violences subies, incité à y confronter sa propre expérience personnelle et ses interprétations, ainsi que les réponses de sa propre tradition religieuse et spirituelle, en vue de les remettre en question et à chercher de nouvelles réponses pour faire face à la violence, voire à utiliser l’énergie de cette violence en vue de construire un monde plus juste et plus humain (et non en vue de détruire l’autre et son monde), le protestant réformé y est aidé aussi par la vie communautaire et les célébrations dominicales entre autres.
Cette confrontation à la Bible et à ses paroles (divines, prophétiques et humaines), l’invite donc à prendre conscience qu’il ne peut exister seul, sans la présence de l’a(A)utre, à entrer dans une relation de confiance et à construire cette confiance (la foi), et à être attentif, de manière sans cesse renouvelée, à sa relation à lui-même, à sa relation à l’autre (partageant ou non sa foi) et à sa relation à D’ieu.
Les manifestations individuelles et collectives de la violence
La violence a toujours, semble-t-il, existé sous diverses formes et a jusqu’ici accompagné l’Histoire de l’Humanité. Par ailleurs, il est clair que toutes les Ecritures saintes et toutes les religions contiennent un potentiel de violence en soi.
D’autre part, la dimension de nature, pour ce qu’il en est de la violence humaine, ne peut être considéré comme la première source de violence depuis le Néolithique. La violence humaine – du moins son acceptation légitime et sa définition – a été et reste une norme sociale; norme sociale qui s’est modifiée au fil du temps. Il semble bien que la vengeance, la prédation économique et la prédation sexuelle soient les trois sources de la violence humaine qui ont conduit à la lente élaboration de la justice.
L’histoire du protestantisme depuis les Réformateurs, des épisodes des Écritures (la Bible) et des récits concernant D’ieu confrontent également le protestant réformé à la réalité de la violence et aux réflexions au sujet de la violence. Sa tradition, la vie cultuelle l’amènent à reconnaître qu’il peut être acteur, victime ou témoin de violence(s). Sa tradition l’encourage à ne pas s’enfermer ni à se refermer dans l’une ou l’autre de ces positions, mais à corriger les risques qu’elles provoquent dans sa propre vie et/ou dans celle de l’autre, en vue de « garder et de cultiver » la vie.
L’Ecriture (la Bible) étant sa référence dans sa pratique et sa relation à D’ieu, sa lecture et ses interprétations du message biblique et évangélique lui donneront les moyens, soit de favoriser, soit de faire reculer la violence dont il – et/ou sa propre communauté-, est capable.
Pour le protestant réformé, la violence est une réalité, sans pour autant être une fatalité. Ainsi, il n’est pas seulement invité à admettre l’existence et la présence de l’autre, ou à la tolérer, mais à «aimer son prochain », et à assumer ses responsabilités à son encontre.
Les paroles imprécatoires contre D’ieu et les paroles de malédiction de D’ieu sont un moyen d’expression, pour le protestant réformé, de dénoncer les réalités mortifères qu’il subit et supporte, elles sont un outil pour dénoncer le Mal à l’oeuvre dans la Création.
Incité et invité à relire les Ecritures et à y découvrir des actions de violences (de Dieu, de peuples ou d’individu) ou le témoignage des violences subies, incité à y confronter sa propre expérience personnelle et ses interprétations, ainsi que les réponses de sa propre tradition religieuse et spirituelle, en vue de les remettre en question et à chercher de nouvelles réponses pour faire face à la violence, voire à utiliser l’énergie de cette violence en vue de construire un monde plus juste et plus humain (et non en vue de détruire l’autre et son monde), le protestant réformé y est aidé aussi par la vie communautaire et les célébrations dominicales entre autres.
Cette confrontation à la Bible et à ses paroles (divines, prophétiques et humaines), l’invite donc à prendre conscience qu’il ne peut exister seul, sans la présence de l’a(A)utre, à entrer dans une relation de confiance et à construire cette confiance (la foi), et à être attentif, de manière sans cesse renouvelée, à sa relation à lui-même, à sa relation à l’autre (partageant ou non sa foi) et à sa relation à D’ieu.
Le commandement d’amour comme les Dix Paroles (les ‘Dix commandements’), dans une certaine lecture, reconnait qu’il y a bien ‘séparation’ entre le ‘nous de la communauté (ou de l’individu) et ‘les autres’, extérieurs à la communauté. Certes les différences de l’autre, des étrangers, peuvent faire peur.
Mais cette ‘séparation’, entendu comme « sainteté » par les Ecritures (hébraïques) donne à entendre qu’il s’agit de comprendre qu’une juste distance doit être construite entre le ‘nous’ et les autres. Cette ‘sainteté’ à cultiver est là pour empêcher la confusion entre soi et soi, entre soi et l’autre et entre soi et D’ieu.
C’est également ainsi que l’ouverture et l’accueil de la communauté à l’autre, sa démarche à l’égard d’autrui, de l’étranger, sa recherche de non accaparement et/ou de confusion de l’autre aident de la sorte l’individu/croyant dans sa démarche spirituelle d’ouverture à autrui.
Dans l’histoire de la tradition réformée, il y a eu des périodes qui ont pu conduire à des dimensions mortifères et de violences à l’égard de l’étranger, du croyant et des communautés d’autres spiritualités. Ces périodes ont toujours été liées à certaines lectures particularistes du message biblique (ex : apartheid en Afrique du Sud où les Ecritures servaient, entre autres, à justifier des attitudes et des pouvoirs violents).
Face aux horreurs que l’on commet aujourd’hui au nom de D’ieu (ou Allah etc.), les religions (les responsables religieux) doivent non seulement condamner tous les actes de violence, mais aussi lutter autour d’elles, et en leur propre sein, pour retrouver le regard que D’ieu porte sur les humains.
Nous avons à prendre conscience de ce qui, dans le fonctionnement même de la religion (de la démarche, de la posture ou de l’attitude religieuse) conduit à l’aberration de la violence, dont les causes sont structurelles, latentes et permanentes :
- la prétention à détenir la Vérité (maladie infantile du monothéisme?) :
- la complicité et l’instrumentalisation réciproque entre pouvoir politique et pouvoir religieux/du sacré ;
- la collusion/confusion entre identité et religion (voir comment, aujourd’hui, dans le contexte actuel où s’exacerbent à la fois la peur de l’autre et l’affirmation des identités collectives, on se tourne souvent vers la religion dans sa forme traditionnelle pour assurer la « défense « de cette identité que l’on perçoit menacée par les flux migratoires).
Prévenir et promouvoir des initiatives de paix, de justice et de réconciliation
De tous temps, les traditions religieuses sont nées dans des contextes socio-économiques et politiques divers et variés qui les ont fortement marquées. Mais dans le même temps, elles ont représenté un refuge et une force de résistance face à ces contextes socio-économiques et politiques. C’est la mémoire de la tradition réformée qui, n’étant pas liée à une identité ethnique ou culturelle particulière, prescrit au protestant réformé d’être attentif au contexte socio-économique et politique dans lequel il vit, afin de pouvoir maintenir ces dimensions de refuge et de résistance toujours accessibles à autrui, à lui-même et à sa tradition.
Bien que pouvant être porteuse de violence, la tradition réformée considère que la violence, même la sienne, n’est pas une fatalité. Que ce soit le ‘Post tenebras lux’ (« Après les ténèbres, la lumière ») ou le ‘Ecclesia semper reformanda’(« Eglise toujours à réformer ») – deux formules propres à la tradition réformée, qui invitent les Églises réformées à toujours se renouveler, à se sentir appelées à aller au-delà̀ de leurs traditions et de leurs liens économiques et culturels, à se mettre dans une écoute renouvelée de la Parole de D’ieu -, elles expriment succinctement mais fermement la conviction que l’ouverture, le dialogue (en particulier avec sa propre tradition), le respect et l’auto-critique sont autant d’antidotes, entre autres, à la violence.
En conclusion (provisoire), nous pouvons dire que le pardon, le respect de l’autre, le renoncement à la violence, l’amour du prochain, comme alternatives à la vengeance et à la violence, vont s’imposer progressivement dans la culture occidentale et dans sa sphère d’influence, comme un mode de vie souhaitable et donc possible. Le « Tu ne tueras pas » apparaît, aujourd’hui, comme l’interdit majeur de nos sociétés, passant du champ du religieux à celui de la société (civile) sécularisée.